(C) Acrylique sur toile de François Robert (détail), collection privée – tous droits de reproduction réservés
Tout au bout de ce long effort mesuré par l’espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur d’où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine.
C’est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m’intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d’un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. A chacun de ces instants, où il quitte les sommets et s’enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher.
Si ce mythe est tragique, c’est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine, si à chaque pas l’espoir de réussir le soutenait ? L’ouvrier d’aujourd’hui travaille, tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce destin n’est pas moins absurde. Mais il n’est tragique qu’aux rares moments où il devient conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l’étendue de sa misérable condition : c’est à elle qu’il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n’est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris.
Si la descente ainsi se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce mot n’est pas de trop. J’imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur était au début. Quand les images de la terre tiennent trop fort au souvenir, quand l’appel du bonheur se fait trop pressant, il arrive que la tristesse se lève au cœur de l’homme : c’est la victoire du rocher, c’est le rocher luimême. Ce sont nos nuits de Gethsémani. Mais les vérités écrasantes périssent d’être reconnues. Ainsi, Œdipe obéit d’abord au destin sans le savoir. A partir du moment où il sait, sa tragédie commence. Mais dans le même instant, aveugle et désespéré, il reconnaît que le seul lien qui le rattache au monde, c’est la main fraîche d’une jeune fille. Une parole démesurée retentit alors : « Malgré tant d’épreuves, mon âge avancé et la grandeur de mon âme me font juger que tout est bien. » L’Œdipe de Sophocle, comme le Kirilov de Dostoïevsky, donne ainsi la formule de la victoire absurde. La sagesse antique rejoint l’héroïsme moderne.
On ne découvre pas l’absurde sans être tenté d’écrire quelque manuel du bonheur. « Eh ! quoi, par des voies si étroites… ? » Mais il n’y a qu’un monde. Le bonheur et l’absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L’erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l’absurde naisse du bonheur.
« Je juge que tout est bien », dit Œdipe, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l’univers farouche et limité de l’homme. Elle enseigne que tout n’est pas, n’a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un dieu qui y était entré avec l’insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d’homme, qui doit être réglée entre les hommes.
Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l’homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l’univers soudain rendu à son silence, les mille petites voix émerveillées de la terre s’élèvent. Appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l’envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit.
L’homme absurde dit oui et son effort n’aura plus de cesse. S’il y a un destin personnel, il n’y a point de destinée supérieure ou du moins il n’en est qu’une dont il juge qu’elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. A cet instant subtil où l’homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d’actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l’origine tout humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n’a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore.
Je laisse Sisyphe au bas de la montagne ! On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.


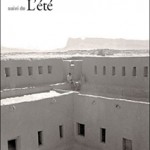


J’ai adoré le mythe de SYsiphe. Mais bon je susi « mytho ». :o)