Un coup d’éclats d’encre
Avant de commencer la lecture de ce recueil de poèmes, je voulais, car je l’ai omis lors de mon dernier article sur Pierre Cendors, remercier vivement Sandrine Fay, l’éditrice d’Eclats d’encre. Pour sa disponibilité, tout d’abord, car il est toujours agréable de correspondre avec une éditrice attentive aux lecteurs qui la sollicitent, allant même jusqu’à suggérer des lectures qui font mouche, tel ce Si peu, tout de Vincent Motard-Avargues, mais aussi Bernard Schürch (qui sera l’objet d’un futur article, j’y reviendrai). Attention professionnelle diraient ironiquement certains mauvais esprits mais c’est avant tout une vraie rencontre et beaucoup d’attentions dans un monde où le temps avance si vite qu’on n’a pas toujours le temps d’en être dispendieux. Et puis aussi, et je me permets de joindre la parole de Vincent1 pour souligner l’énorme travail qu’elle accomplit au quotidien, auprès des auteurs (ça c’est lui qui me l’a dit), auprès des lecteurs et également pour la poésie en générale. Pour l’idée même de la poésie vivante, de la parole vive. On peut regretter que la poésie contemporaine soit une des parties les moins visibles de « l’industrie littéraire », qu’elle ne soit pas dotée d’un plus large public, d’un plus large soutien de la part de l’État (qui retire cette année une grande partie des aides accordées pour le Printemps des poètes, retrait qui d’ailleurs ampute, à mon avis, davantage le spectacle vivant que la poésie, car il n’est besoin de rien pour écrire ou lire de la poésie) mais la poésie est debout, peut-être chancelante pour certains, mais debout. Elle ne rampe pas plus, ni n’a le privilège de la distinction comme l’affirmait avec véhémence Léo Ferré dans les année 70. Les temps sont durs, durs pour la culture en général, très durs pour la poésie en particulier, mais heureusement il y a toujours, et je pense souhaite qu’il y aura toujours des Sandrine Fay, des Angèle Paoli, des Florence Trocmé, et beaucoup d’autres (je ne peux pas tous les citer ici mais j’ai volontairement mentionné des femmes qui font de leur engagement dans la défense de la poésie un exemple), des revues poétiques (je pense à Recours au poème qui plus qu’un blog, est un espace vivifiant dans lequel se meut la parole poétique plurielle), des associations ou tout simplement des poètes pour lui faire garder sa dignité et sa rage d’exister. Et pour rendre quelque peu visible, lisible ce qui est écrasé et noyé dans la masse (parfois effrayante) du marketing littéraire global. Au nom des lecteurs et des amoureux de poésie, dont je ne suis qu’une ombre parmi d’autres, merci.
Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves.
Seules les traces font rêver.
René Char, La parole en archipel
Traces
Je cherche
Tes traces.Vincent Motard-Avargues, Si peu, tout, p. 47
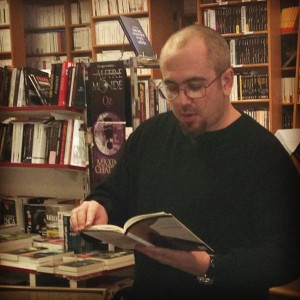
Lecture de Vincent Motard-Avargues à la librairie Espaces livres
Si peu…
Ce livre n’est pas un recueil de poèmes à proprement parler mais est plutôt un poème à lui tout seul. Un poème éclaté, « pulvérisé » en plusieurs fragments, bribes, et même et surtout troué par de nombreux silences. Une parole qui, sous la force d’une pression intense, sous la violence d’une émotion brutale, aurait fini par exploser, par se disséminer dans le livre. Le livre serait alors ce champs de bataille, quand tout est redevenu calme et « normal » – chants d’oiseaux, ciel dégagé, végétation reprenant ses droits – de ces éclats de paroles, de ces traces (et non de ces preuves comme le souligne si justement René Char dans La parole en archipel) d’un chaos qui s’éloigne du présent toujours en mouvement. Dépôts des bris des voix intérieures. Cet éclatement est inscrit dans la mise en page même du poème où les mots sont littéralement disséminés dans le corps de chaque page. Sans aucune ponctuation. Car en définitive seuls les événements et les sentiments ponctuent nos phrases, nos hésitations, nos repentirs, nos douleurs…
Ce livre est un livre de deuil. Celui de l’enfant fauché et soustrait à sa vie en devenir, le deuil d’un cygne qui s’ignorait. Par métonymie, ce chant devient aussi deuil de l’enfance, un renoncement qui peut sembler inévitable pour qui en est déjà sorti et pourtant, parfois, non…
Le poème se situe plus précisément au moment du rite funéraire, au moment où l’adieu à l’être prend une forme concrète, marque sa déchirure irrévocable qui deviendra l’absence coutumière des lendemains. Car, si l’instant de cette séparation semble se situer en dehors de toute temporalité connue (c’est un événement très ponctuel, voire même très émotionnellement fulgurant, mais qui s’inscrit dans une durée, qui ricoche sans cesse, qui s’installe dans la répétition du même instant), les demains, eux, reprendront inévitablement leur cours. « Je dormirai | demain | quand la lune | m’assommera », (p.22). Cependant, cette parole qui s’élève ne ressemble en rien à une oraison funèbre : il ne s’agit pas tant de réinvoquer dans le verbe ce qui a disparu, de rappeler aux vivants « le marteau | carmin | de la souvenance » (p.17) que de décrire avec précision les multiples décalages qui opposent dans ce contexte le dehors au dedans, et qui s’agitent, et qui vibrent jusqu’au non sens et soulignent avec une cruelle ironie là où il y a la vie et là où il n’y en a plus (« Il y avait | un rire | il n’y en a | plus » p.34).
C’est donc une approche phénoménologique du deuil que nous convie à explorer (à res-sentir en puisant dans sa propre expérience) Vincent Motard-Avargues. Approche qui contient ses tensions et qui oscillent sans cesse entre ce que l’on voit à l’extérieur et «ce qui | reste | quand on | ferme les yeux ». Cette tension est cernée également pas l’usage des parenthèses qui soulignent toutes les chose qui se passe à l’intérieur, et qu’on ne voit pas depuis le dehors. Les parenthèses qui adossent une vérité à ce qui n’est qu’une apparence, ce pourrait être le rôle du chœur dans la tragédie. Par ce jeu de tiraillement, la phrase syncopée devient spirale, le monde vacille, tournoie. On voit, on ressent. Les choses passent, les impressions s’effacent, sont aussitôt remplacées par d’autres impressions, « ([la] tête | tourne)», ce qui était familier devient totalement étranger, jusqu’à soi-même (« Je marche | Je marche | Je marche | qui sont ces | pas » p. 32).
Le ton pourrait être lyrique, pathétique. Mais non. Du je, il est parfois question mais pour le vouer à une sorte d’auto-dérision (« (Je souris | de moi | tristement | ridicule)» p.42) car le je n’a plus vraiment d’importance. Ce je (« si lâche ») est celui qui reste dans le monde des vivants, il peut alors symboliquement s’effacer, être avalé par la lumière, devenir ombre (p.28)… Mais ce je est aussi celui qui va planter le fruit, (« Je sème | rose en terre || Tu pousseras | au dehors de cette | absence », magnifique avant-dernière page qui résonne avec force) avant que le vide envahisse totalement le présent. Fruit-grenade qui en explosant dissémine ses graines dans le livre comme autant de traces à suivre…
L’écriture de Vincent est très maîtrisée et très travaillée sans qu’on en ressente un quelconque artifice. Si j’ai associé ce recueil à René Char ce n’est pas tant dans le style (bien que Char soit également un poète du fragmentaire, de l’éclatement de la parole) que dans l’aptitude à capter une parole vive et brute tout en lui conservant une fragilité et une beauté ineffable. Je pourrais être plus prolixe encore sur ce que m’a inspiré ce poème (notamment sur l’usage de la persistance rétinienne : « ce qui reste quand on ferme les yeux ») mais j’ai déjà beaucoup plus de mots au compteur que le poème en lui-même et il y a tant pour vous, amoureux de la poésie, à découvrir qu’il faut ne pas trop écraser les traces au risque de les transformer… (C’est systématique, je ne peux m’empêcher, lorsque je parle de poésie, d’avoir en boucle cette phrase de Barbara : « Ne pas parler de poésie en écrasant des fleurs sauvages« ).
Un dernier mot encore, le hasard m’étonnera toujours car enchaînant sur un autre recueil de poésie, Soleils insurgés de Bernard Schürch, je tombe sur cet incipit qui résonne étrangement après la lecture de Si peu, tout :
Nous ne sommes rien ; c’est ce que nous cherchons qui est tout.
Ce qui ne peut m’être tout, pour l’éternité, ne m’est rien. Hölderlin, Hypérion (fragment Thalia)
Pour aller plus loin…
- Les éditions éclats d’encre et sa page facebook
- Le blog photographique de Vincent Motard Avargues (dont la photo en tête de cet article publiée avec l’aimable autorisation de l’auteur)
- Sur Chemins battus, le blog de Morgan Riet
En infra...
- Informé par Sandrine Fay, j’ai eu le plaisir de rencontrer Vincent Motard-Avargues lors d’une lecture à Gradignan, à la librairie Espaces Livres, en compagnie d’une autre poétesse : Brigitte Giraud, auteur du récent recueil Seulement la vie, tu sais aux éditions Raphaël de Surtis. Je reviendrais sans doute sur ce livre que je n’ai pas encore lu. [↩]
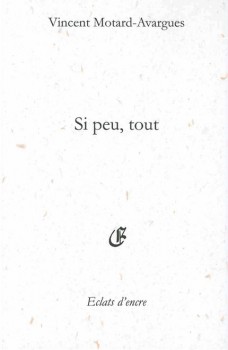


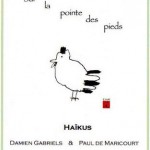


(Pardon, mais il me semble que c’est Hölderlin.)
(Très juste, c’est corrigé. Merci)