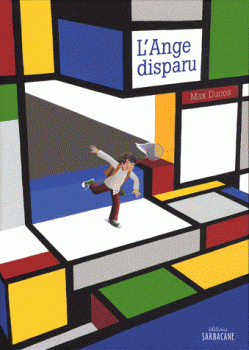De quelle idée, suis-je la biographie ?
De quelle silence cette parole née ? L’homme caché, Pierre Cendors, p. 113
Je dédie ce texte : à Julie, en guise de réponse
à sa question : Comment « ressentez »-vous la lecture ?
A Marianne que j’ai finalement trouvée
Et à l’ange perdu qui m’accompagna ce jour-là.
Comment le livre nous trouve-t-il ?
Rencontrer un livre ou un auteur procède toujours d’un mystère qui nous échappe. Quand je dis rencontrer, je veux dire rencontrer vraiment. Pas physiquement bien sûr ! Je dis le mot « rencontrer » et l’image qui me vient immédiatement à l’esprit est celle d’un puzzle dont il manque la dernière pièce, l’essentielle, celle qui viendrait combler ce vide, central à l’édifice. Rencontrer, c’est trouver cette pièce qui, étant toujours déjà en avance sur sa propre absence, sur notre propre quête, exacerbe une incomplétude secrète et à jamais repoussée. Heureusement, nous avons toujours des milliers de puzzles en construction, et il s’en trouve toujours quelques-uns pour lesquels, par la force du hasard ou par obstination, une pièce surgit du néant.
Les auteurs que l’on rencontre, selon cette définition, se comptent sur quelques mains pleines de doigts. Duras fut pour moi une rencontre. Woolf, Borges, Rilke, Pérec, Blanchot, Char, Jabès, Quignard récemment. J’en oublie quelques-uns. Et là, je cite les auteurs, mais la rencontre n’embrasse généralement pas l’œuvre complète, elle tient à la révélation d’un texte ou deux : Lol V. Stein, To the Lighthouse, Fictions, etc. Bien sûr, une fois un auteur découvert, on se lance dans la lecture frénétique, dans la répétition compulsive : on veut réitérer la rencontre, le miracle (au sens de merveilleux), au détour d’une phrase, dans le geste anodin d’un personnage, dans le frémissement d’un courant d’air, dans le bruissement de la langue…
La question qu’on se pose rarement, c’est : comment est-ce que cela arrive ? Par quel hasard, par quel cheminement inopiné, par quel lien se dirige-t-on vers un auteur, vers un livre plutôt qu’un autre ? Est-ce l’instinct ? Est-ce le charisme de l’auteur ? Est-ce l’illustration sur la couverture ? La quatrième ? Est-ce l’école, les bibliothèques, les salons, les libraires, les marchands ? Est-ce un autre livre ? Est-ce internet et les innombrables réseaux de blogueurs-lecteurs ? Est-ce les médias, la télé, la radio ? Est-ce un ami, un voisin ? Est-ce un étranger qui laissa pour vous cet Atlantide englouti sur ce banc ? Il y a un peu de tout cela en ce qui concerne la découverte, mais pour la rencontre ? Une partie des auteurs que j’ai cités au-dessus sont des rencontres – quasi inévitables – de mon cursus scolaire et littéraire, une autre, la part des poètes, me vient de ma mère comme je l’ai déjà raconté ici. Mais les autres ? Seul le labyrinthe connaît le secret cheminement qui les pousse jusqu’à nous.
Digression 1 : Escale pour un livre
Tenez, je vais faire un détour, avant d’entrer dans l’objet initial de cet article à savoir la rencontre et la lecture de L’homme caché, et vous raconter les moments qui ont précédé ma rencontre avec Pierre Cendors. Depuis une dizaine d’années, je me déplace rarement aux salons du livre. C’est un préjugé tenace chez moi (et peut-être une certaine forme de snobisme que je tends à corriger), mais je trouve que le lieu n’est pas propice à une quelconque rencontre avec des livres. On y est serré et bousculé. L’atmosphère qui y règne est pesante, embourbée dans cette économie marchande de l’objet-livre qui voudrait en faire un commerce prospère quand les badauds, comme moi, viennent surtout y chercher de la littérature, du rêve et de la rencontre. Et ça crie dans le haut-parleur : « l’auteur untel signe en ce moment son dernier livre au stand 21 des éditions trucs-muche ». L’apogée de la littérature entrée dans l’ère de l’événement. On y croise aussi certains auteurs, une pile de livres posée devant eux, assis et ne trouvant aucune contenance face au péril de cette mise en spectacle, assis et découragés face à au vide que constitue leur lectorat absent. C’est une image de la solitude de l’écrivain qui m’émeut, sincèrement.
Cette année, une fois n’est pas coutume, j’avais décidé de me rendre à l’Escale du Livre, salon annuel à Bordeaux. J’avais prévu d’y aller seul, mais allez savoir pourquoi, la veille, je décidai d’emmener Matisse, mon fils de sept ans. Je savais déjà, alors que le tramway franchissait la Garonne, qu’il allait falloir concilier entre flânerie vaguement rêveuse et attraction nécessaire pour maintenir la curiosité de mon fils. Je savais déjà que je n’irais pas, comme j’avais osé l’imaginer, écouter Onfray faire sa présentation de la philosophie de H. D. Thoreau. Toute initiation exige de soi une part de sacrifice que l’on transmet à l’autre : ce que l’on perd d’un côté se retrouve offert au centuple de l’autre côté, dit-on. C’est donc avec une espérance de bonheur que je narguais la longue file d’attente devant la salle du conférencier, et m’engouffrais dans le salon avec mon gamin. Je m’étais fixé un objectif secondaire en venant à cet endroit : trouver une certaine Marianne pour établir un premier contact (je m’étais engagé à écrire un article pour la revue qu’elle dirige et j’aime, dans la mesure du possible, passer du virtuel au réel). Ne l’ayant jamais vu ailleurs que sur la photo de son profil et considérant la foule, venue nombreuse au salon, j’abaissai rapidement mon objectif de secondaire à tertiaire, de tertiaire à probable, de probable à « on va laisser le hasard faire son œuvre »…
L’ange disparu
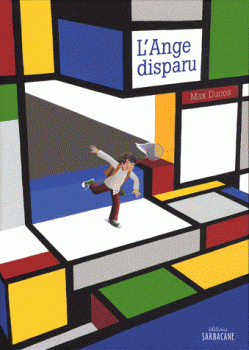
Digression 2 : L’ange a disparu
La visite du salon avec mon fils se déroulait bien. On commença par le secteur jeunesse. Les enfants veulent tout acheter, comme leurs parents, c’est bien connu. Aussi, devançant cette acquisition présumée compulsive et désordonnée, je limitai l’achat à un livre, en insistant sur la nécessité de bien choisir, de prendre son temps, de fureter, de feuilleter, de toutes ces sortes de conseils que les parents consciencieux trouvent bon de donner… Ce fut néanmoins rapide car, à peine avions nous franchi le seuil du premier stand, qu’il fondit littéralement (en poussant des petits cris : celui là ! celui là !) sur un livre très coloré, aux formes et aux couleurs de Mondrian, intitulé : « L’ange disparu » de Max Ducos. Étonné par la rapidité de son choix et passablement déçu du peu d’écoute que trouvèrent mes conseils avisés (et je le soupçonnais dans le fond d’avoir cédé à la compulsion, le livre avec son grand format et ses couleurs vives perçait l’étal, on ne voyait que lui, tel un totem marketing planté en plein désert), je tâchais de le faire parler : Mais pourquoi celui-là ? Pourquoi pas un autre ? Ne veux-tu pas en feuilleter d’autres ? Le questionnant, je parcourais et jaugeais le livre : un enfant visite un musée quand il est soudain interpelé par une Vénus qui lui apprend que son petit ange a disparu. L’enfant mène son enquête dans le musée, interrogeant les tableaux qui l’aident à trouver l’angelot. Passant de tableau en tableau, la quête – et le livre – est une occasion de se promener à travers toute l’histoire de l’art, de Poussin à Yves Klein… Non non ! celui-là ! insista-t-il en m’expliquant alors que cette histoire, il l’avait vue cette année, lors d’un spectacle à l’espace culturel… Cela me revint : des amis l’avaient en effet emmené voir une adaptation de ce livre (mise en scène par la Cie Les marches de l’été) et je me souvins de son enthousiasme à nous raconter l’histoire, pêle-mêle… Sa mère et moi ne comprenions pas toujours, mais ç’avait l’air d’être vachement impressionnant comme histoire…
Cette histoire l’avait marqué : elle était mystérieuse, faisait référence aux tableaux comme il y en avait dans les livres de son art-plasticienne de mère, abordait des thèmes qui interrogent les enfants : la séparation, la perte de soi, l’errance, la peur… Son choix n’avait donc rien de compulsif mais répondait à des questions qu’avait posées le spectacle. Sans doute espérait-il, à travers ce livre, y trouver quelques réponses… Et puis enfin ! Comme Eloi, le petit garçon, nous avions, nous aussi, trouvé l’ange disparu ! Nous ne pouvions pas l’abandonner ici. C’est ainsi que nous l’embarquâmes dans notre frêle esquif.
L’heure du retour en Ithaque n’ayant pas sonné, nous reprîmes la route.

Digression 3 : Impasse de l’étroit chemin du fond
Nous continuâmes, l’ange, mon fils et moi, à dériver une petite heure parmi les livres jeunesse puis nous abordâmes le pavillon des livres pour les grands. Cheminant de stand en stand, feuilletant un livre par ici, regardant les couvertures des autres par là, scrutant de temps en temps les visages dans l’espoir d’y trouver celui de Marianne, je reconnus soudain Alain Walter, mon professeur de littérature comparée de deuxième année de Lettres Modernes : il dédicaçait sa traduction de Bashô, L’étroit chemin du fond, sur le stand des éditions William Blake. En grande discussion avec un couple, j’attendis patiemment mon tour de l’aborder et de lui parler un peu. Lui m’avait fait rencontrer Moby Dick, un jour. Peut-être avait-il des nouvelles du capitaine Achab, qui sait ? Avec lui, je m’étais engouffré dans la jungle, au milieu de nulle part, là où se trouve le Partage des eaux d’Alejo Carpentier. Souvenirs lointains mais vivaces, ces lectures remontaient en moi tandis que j’observais patiemment mon professeur. Avec lui, j’avais écrit mon premier mini-mémoire sur Marguerite Duras : « La recherche psychanalytique du Père dans l’Amant« , quelque chose de cet acabit, je l’ai encore dans un carton. Au-delà de la lecture et de l’étude psychanalytique de l’œuvre, je me souvins du plaisir que j’avais pris à réaliser ce mini-livre comme si ç’avait été une vraie édition. A l’époque les moyens informatiques étaient rudimentaires : l’épreuve avait été tirée en un exemplaire sur une imprimante matricielle, reliée artisanalement, et j’avais agrémenté la couverture d’une illustration que m’avait faite, pour la circonstance, Cécile, mon art-plasticienne de compagne. J’avais eu une très bonne note et en avais été pas peu fier.
Je feuilletais l’ouvrage de Bashô, à la couverture sobre et intrigante. Je me rappelais que Walter parlait souvent du Japon dans les digressions qu’il s’accordait, des voyages qu’il avait faits, du temps où il était lecteur là-bas… Matisse me tira soudain de ma rêverie. Le temps, pour les enfants, s’étire proportionnellement par rapport à l’inaction qu’il propose. Il chavirait comme un bouchon dans l’eau, il voulait bouger, voir je ne sais quel truc qui avait attiré son regard. La discussion paraissait sérieuse entre l’auteur et ses lecteurs, je remis ma rencontre à plus tard… Par la suite, à chaque fois que je passais devant son stand, il était affairé à discuter avec des personnes différentes… et je me dis que Bashô avait bien de la chance d’avoir trouvé comme ambassadeur de son œuvre un homme aussi dévoué, cultivé et patient que mon professeur de littérature comparée, mais ce ne sera pas pour moi, pas cette fois-ci. Il est des rencontres qui se réalisent et d’autres auxquelles on doit renoncer : la barque avance, la berge est immobile. Seuls les souvenirs confèrent aux rives un semblant de mouvement.
1837 – 1840, journal

Digression 4 : Île de la finitude
Sortant de l’étroit chemin du fond, l’ange, mon fils et moi nous tombâmes, en plein milieu du salon, à mille et mille lieues de tout terre habitée, sur une île : celle des Éditions Finitude. Je me souviens alors que Marianne avait répondu, sur Facebook, à l’invitation desdites éditions en précision qu’elle serait présente sur ce stand. Peut-être la trouverais-je, perdue, sur cette île, pensais-je. De plus, c’était la maison qui publiait, en intégralité, la traduction du journal de Thoreau. A défaut du conférencier, je pouvais au moins satisfaire ma curiosité en achetant ce livre qui m’avait attiré ici comme un phare au milieu du salon. Je prévenais mes moussaillons que nous jetions l’ancre ici quelques temps, jusqu’à l’heure du déjeuner. Ils firent la moue, résignés, mais la perspective du repas approchant leur permit de patienter. Matisse se mit à parcourir son livre et l’ange à jouer à cache-cache avec lui…
Vous avouerais-je que je ne connaissais pas cette maison d’édition, pourtant bordelaise, pourtant décennaire, pourtant à l’origine d’un fonds de publication de qualité, tant par les choix éditoriaux que par la facture de ses livres. Les couvertures avaient toutes une allure un peu vieillotte, rétro, comme imprimées au siècle dernier : gravures, collages, vieilles photographies… Pas de jaquettes rutilantes en papier glacé, pas de pages éclatante de blancheur, pas de portrait d’auteur en quatrième de couverture, la plupart des livres au format de poche… Cet ensemble donnait l’illusion qu’on se trouvait davantage sur le stand d’un bouquiniste que celui d’une maison d’édition. Et ce n’était pas pour me déplaire : les bouquinistes, comme les disquaires, sont souvent des passeurs de rives avec cette particularité, toute appréciable lorsque l’on est humain, d’être en chair et en os. Et comme passeur de rives, on ne peut guère faire mieux que les éditions Finitude : La maison édite en effet de jeunes auteurs mais aussi des textes et des auteurs plus anciens, souvent oubliés, marginaux, parfois orphelins. Et c’est bien là aussi la mission d’un libraire : donner à l’inconnu sa chance de visibilité. L’éditeur est un capitaine, navigant à vue, capable d’extirper n’importe quel matelot de la brume informe que constitue la création littéraire, et de le ramener sur nos côtes. Après il peut choisir de s’arrêter là et se contenter uniquement de faire jongler les marins, mais c’est un autre métier, il faut bien le reconnaître…
Je trouvais rapidement, car mis en évidence, le Journal de Thoreau. Je tombais également sur un petit livre, intitulé A bord, d’Herman Melville. Sur la couverture, un galion qui me fit penser aux livres d’aventures que j’empruntais à la bibliothèque de l’école dans lesquels j’étais embarqué avec ses flopées de pirates, de flibustiers à la recherche d’hypothétiques îles au trésor…
A bord

Un jour, en début de soirée, alors que j’étais au large des côtes de Patagonie, écoutant une dramatique histoire de fantômes que racontait un des membres de l’équipage, nous entendîmes un affreux mugissement, quelque chose entre le grognement d’un Léviathan et l’éructation d’un Vésuve, et nous vîmes une brillante traînée de lumière à la surface de l’eau. Le vieux maître d’équipage grisonnant, qui se tenait tout près, s’exclama: «Là, c’est un Poisson du Diable !».
Lisant cela sur la quatrième, je me dis que ce livre me donnerait sans aucun doute des nouvelles du capitaine Achab…
Je ne ferai pas ici la narration exhaustive des trésors découverts sur cette île déserte : Svevo parlant de Joyce, traité de typographie inusuelle ou traité du cafard, Cioran traduit en rébus… Je vous laisse par vous-mêmes en découvrir le contenu mirifique dans les pages de leur catalogue.
Matisse m’avertit des remous agitant notre embarcation (et son estomac) et de la nécessité absolue de lever l’ancre afin de trouver pitance dans des eaux plus poissonneuses. J’allais enfin donner les deux livres choisis à l’ilien sympathique qui tenait ces lieux, quand mon regard fut attiré par une couverture ornée d’un labyrinthe au milieu duquel une silhouette mystérieuse semblait chercher son chemin. Au-dessus on pouvait lire :
L’homme caché, romans,

Curieux, et comme à chaque fois émoustillé quand il s’agit de labyrinthe, je lus la 4e de couverture.
– Que savez-vous de moi ?
– Ce qu’on a dit à votre mort, un peu partout : poète visionnaire, homme caché, secret, solitaire, dont la disparition accidentelle à Prague, a façonné une légende, fixé l’élan romantique pour les jeunes générations. Je crois que c’est à peu près tout.
– Vous pouvez me poser une question.
– Pourquoi êtes-vous mort au juste ?
C’était bien assez pour me convaincre de l’impérieuse nécessité de lire ce roman présenté comme le premier de son auteur. Je tendis alors trois livres. Tout en réglant mon achat je demandais, à tout hasard, si l’îlien connaissait ou avait vu une femme répondant au nom de Marianne. La personne me répondit aimablement : « Oh vous savez, moi je suis un ami des éditeurs, je tiens le stand pendant qu’ils assistent à la conférence de Michel Onfray… Je ne peux guère vous aider. Mais vous allez la trouver… » Je ne vis ni Thoreau, ni Onfray, ni Walter, ni Achab. Marianne était restée introuvable. Mais au moins, mon fils et moi, tandis que l’étincelant vaisseau nous ramenait prestement en Ithaque, nous avions la joie et le plaisir de ramener avec nous un ange disparu et un homme caché. La vraie rencontre avec Cendors eut évidemment un peu plus tard, mais là c’est une autre histoire…
Ecrire en marge